Le texte de l’évangile, sur le site de l’AELF.
Le texte qui nous est donné ce dimanche est un découpage bizarre, comme je l’ai déjà expliqué sous le titre Notre échelle de valeur, tout en essayant d’en donner une explication de texte pas à pas et générale.
Qui sont les scribes ? Car le texte dit clairement qu’il faut s’en méfier… Le scribe dans la tradition hébraïque est le [sôfer], « l’homme de sagesse« , l’homme de l’écrit. A l’origine, ce sont des fonctionnaires de cour, ceux qui maîtrisent l’écriture et qui à ce titre tiennent aussi bien les chroniques que les comptes. Ce sont eux qui sauront mettre par écrit les récits religieux d’Israël, les conserver, les combiner, les augmenter. Il s seront à l’origine de la production de ce que nous appelons les « écrits de sagesse » : psaumes, proverbes, Qohélet, Job… (on trouvera plus à ce sujet dans l’excellent résumé d’André Paul, Les scribes d’Israël, maîtres de l’écriture et gardiens des écritures). C’est dans leurs milieux que naît l’anticipation du salut sous la figure du « Fils de l’homme »: ils sont sûrement à la fois surpris et intéressés que Jésus reprenne ce vocable pour se l’attribuer. Ils ont en tous cas l’autorité de ceux qui savent lire et écrire, c’est-à-dire qu’ils ont le sens des mots, de leur poids, de leur valeur. Au fur et à mesure que les traditions sont devenues l’Ecriture, leurs avis sont devenus de plus en plus écoutés, ils sont devenus les gardiens de la lecture autorisée ou non des Ecritures.
Je me rends compte, cher lecteur, que je dois m’inclure dans cet ensemble : même si ma contribution est fort modeste, et même si je ne fais pas autorité, le fait que je m’attache à scruter les textes et à en publier ce que j’y découvre, fait de moi un « scribe » : et dès lors, cher lecteur, aux termes de l’évangile d’aujourd’hui, il te faut te méfier de moi ! En tous cas, (le texte recommande [blépété apo]), il faut m’observer, moi et les autres, avec distance et exercer ton jugement au sujet de ce que je dis. Et pourquoi ? Mais tout simplement parce que, prétendant parler sur la base des textes fondateurs, ma parole risque d’avoir à tes yeux leur autorité : ce qu’au dieu ne plaise ! Autant nous pouvons toi et moi regarder ensemble un texte qui fait partie du « texte fondateur » et y accorder une autorité, autant ce que nous en disons toi ou moi n’est que notre regard, un regard partiel (et peut-être partial). La meilleure distance serait une somme de regards croisés : et j’aimerais tant que chacun ose écrire aussi ce qu’il voit dans ces textes, de sorte que tout lecteur trouverait non pas un commentaire, mais une pluralité de commentaires, ce qui alimenterait et libèrerait en même temps son regard. Car ce qui compte avant tout, c’est la confrontation de chacun, directement, avec la parole de dieu, contenue dans les Ecritures. Non avec la parole d’un scribe, aussi sympathique soit-il…
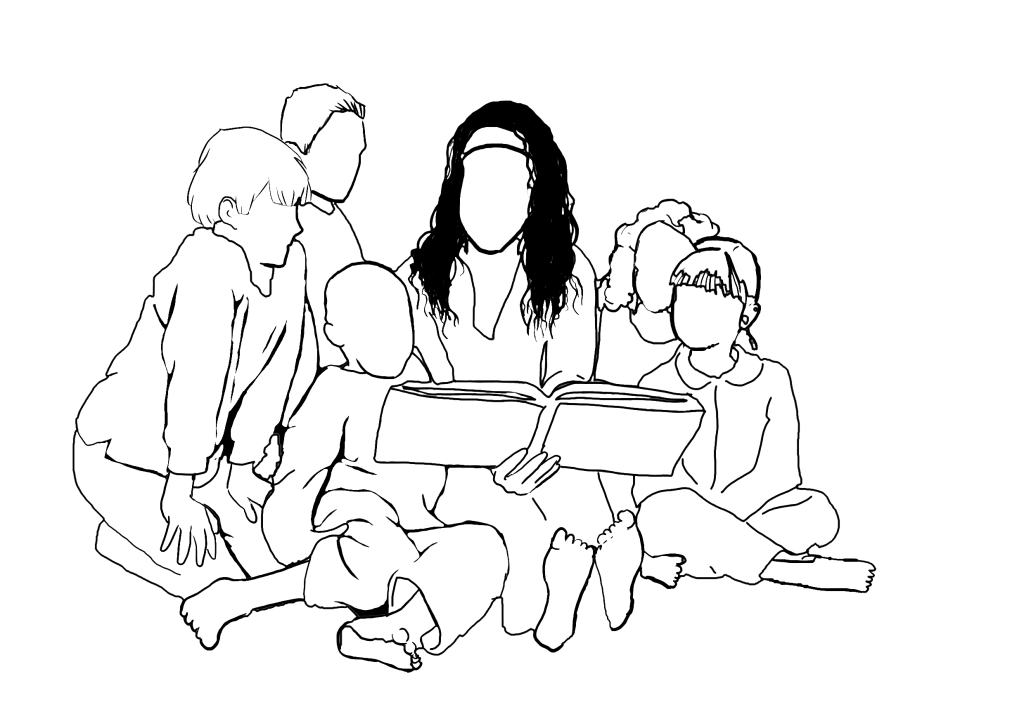
Cette prise de distance, le texte de Marc la recommande en particulier avec ceux des « hommes de sagesse » qui « veulent circuler en habit et embrassades dans les places publiques et premières chaires dans les synagogues et premières places dans les dîners. » On voit ici se dessiner, avec le pittoresque particulier de Marc (on dirait qu’il peint des petites miniatures, un peu comme Maupassant), tout un contexte. Il est possible de se placer à côté et au milieu de tous pour lire avec eux, en même temps, les Ecritures. Mais il est aussi possible de s’appuyer sur elles pour se faire une place sociale, pour se poser en société : ce qui suppose, au lieu de se mettre au niveau de tous, de se situer à part au contraire, comme possesseur exclusif d’un savoir essentiel à tous.
Cela va se traduire par un costume particulier (circuler en habit), cela va se traduire par des attitudes démonstratives (embrassades dans les places publiques), ou même une certaine compromission avec le pouvoir de l’argent : car [agora], que j’ai traduit ici par « place publique« , est avant tout le « marché« . Et en général, quand on fait des embrassades dans les marchés, c’est qu’on a conclu des accords ou qu’on cherche à le faire… Donc, dans le contexte général de la société de la cité, ces scribes vont tirer leur épingle du jeu, jouer la carte de la mise à part : non par le retrait total de la société, mais par une manière de la fréquenter en y jouant un rôle à part, tant par l’image (le vêtement) que par la fréquentation du pouvoir (le marché ou la place publique).
Cela va se traduire encore, sur le versant « propre » de l’univers religieux, par la revendication de la primauté : celle de l’enseignement explicite (premières chaires dans les synagogues) comme celle de l’autorité sur la vie domestique (premières places dans les dîners). Dès qu’on arrive dans la sphère religieuse, ces « scribes » sont premiers, sont les plus importants, sont les « principaux » : le préfixe [prootôs] est le même que, la semaine passée, nous avons trouvé pour désigner le commandement principal, celui qui est au principe de tous les autres ! Dans l’univers religieux, donc, ces « scribes » s’appuient sur le commentaire autorisé qu’ils font des Ecritures pour se situer au principe de toute vie religieuse : ils sont les incontournables, aussi bien par les avis qu’ils rendent (la chaire) que par l’organisation sociale qui se fait autour d’eux (les dîners).
Une fois lu tout cela, ce passage me semble d’une actualité saisissante dans le débat qui, suite au rapport de la CIASE, porte sur l’organisation ecclésiale, le « système » : débat bien antérieur il est vrai, puisque nous avons, décrit ici d’une manière aussi imagée et concrète qu’efficace, ce qui constitue le « cléricalisme » dénoncé entre autres par François lui-même. Un système où certains, sous couvert d’une autorité fondée sur une aptitude à lire et interpréter les Ecritures, les textes fondateurs, s’arrogent une place proche du pouvoir dans la société en général et organisent autour d’eux cette société spécifique à caractère religieux que l’on appelle l’Eglise. Un système qui ouvre à tous les abus, car il y devient trop facile de se confondre aux yeux des autres avec le dieu qui parle dans les Ecritures : et c’est exactement ce qui s’est passé dans les trop nombreux cas de violences sexuelles, et c’est exactement ce qui se passe dans les trop nombreux cas d’abus spirituel, et c’est exactement ce qui se passe dans tant de situation d’abus d’autorité.
Alors que tout change si, loin de se situer au-dessus et à part, les « scribes » se situent au milieu de et avec. Si les prêtres, si les évêques, se situaient au milieu et avec leurs fidèles dans des recherches et des décisions communes, en faisant simplement profiter tous de leurs compétences et peut-être de leurs charismes en matière d’interprétation des Ecritures, tout serait bien différent… D’autant que les charismes sont, en quelque sorte, vérifiés par ceux au bénéfice de qui ils sont accordés à certains : on aura vite fait de voir si tel ou tel usurpe ou non sa place, si les avis qu’il donne sont éclairants ou pas. Evidemment, il faut que les clercs soient prêts à se déprendre du pouvoir qu’ils usurpent depuis près de deux mille ans, mais il faut aussi que les fidèles soient prêts à assumer leur part des décisions dans la communauté croyante, donc à renoncer à la confortable situation de se faire « diriger ».
Je continue ma lecture du texte : je remarque au passage ce « trésor » du temple dont je ne trouve toujours pas trace -pas plus qu’il y a trois ans-, celui qui a été pillé par les envahisseurs assyriens-babyloniens. Mais justement, il se trouve qu’un tronc avait été instauré (déjà !!!) pour que les fidèles puissent participer à la reconstruction du temple de Jérusalem. C’est peut-être bien près de ce tronc que se trouve Jésus, et alors l’épisode de la veuve est un pont entre ces avertissements à tous au sujet des responsables religieux et le « discours apocalyptique » qui va suivre, lequel est construit sur l’annonce de la destruction du temple. J’y reviendrai une autre fois.
Pour l’heure, je suis également saisi par cette femme, cette veuve. J’ai déjà décrit sa situation il y a trois ans. Aujourd’hui, elle m’apparaît comme une figure des personnes qui sont dans la nuit de la foi. Elle a perdu tout appui, elle n’a plus personne sur qui compter dans sa vie. Ainsi peut-être de celles qui sont ébranlées profondément dans leur foi, soit qu’elles aient perdu ceux sur qui elles appuyaient leur foi, soit qu’elles aient découvert que ceux-ci ne méritaient pas la confiance qu’elles leur accordaient. Et les voilà seules, avec l’impression d’avoir perdu jusqu’à l’époux de leur âme, l’époux de leur cœur : comment ce rejoindre ce dieu qui désormais ne répond plus ?
Tout de même, cette veuve donne au trésor, pour la construction du temple, deux piécettes, qui constituent « toute sa vie » : elle met sa vie en danger, malgré sa situation, malgré sa grande précarité, pour que s’édifie la « maison du dieu ». Elle risque sa vie. Je pense à tous ces humbles qui mettent leur vie en danger pour secourir d’autres personnes, pour que s’édifie ici-bas un monde autre. Je pense à ces gens qui prennent le risque de longs jours passer en mer pour récupérer des réfugiés en danger de mort, des réfugiés dont tous ont abusé tout au long de leur parcours, et qui ne sont pas souhaités là où ils vont : et ces gens qui les recueillent prennent le risque du même rejet que celles et ceux qu’ils ont secouru. Je pense à ces gens qui risquent leur vie autour de Briançon pour ne pas laisser périr dans le froid et la neige ces réfugiés qui vont tenter de passer la frontière malgré toutes les interdictions. Mais je pense à tous ces gens, il y en a plein la vie quotidienne, dont l’engagement (peut-être secret) envers un autre ou d’autres, fait basculer quelque chose dans leur vie. A tous ces gens qui ne sont pas des héros -et il ne faut pas qu’il le deviennent !-, qui jettent deux piécettes, mais cela met leur vie en danger.
Ce sont ceux-là, pas les « scribes » précédemment décrits -qui ne se mettent pas en danger, qui donnent, oui, mais de leur surplus-, qui construisent le royaume. Et c’est vers ceux-là que le maître regarde, alors même qu’ils éprouvent, eux, qu’ils n’ont plus personne pour appuyer leur vie. Toi aussi, même si tu as le sentiment d’avoir perdu pied et d’être seul dans ce que tu affrontes, il te regarde quand tu engages ta vie, et pas un de tes gestes n’est perdu pour lui.
Un commentaire sur « Situer l’autorité (dimanche 7 novembre). »