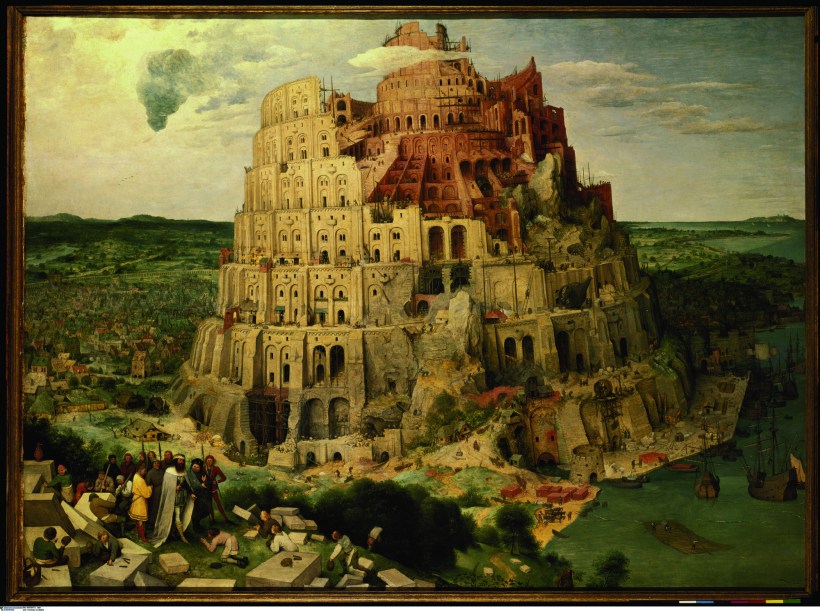Le texte de l’évangile sur le site de l’AELF.
Pour situer le texte :
La grande section qui situait les choses dans la montée vers Jérusalem est terminée : elle fait place maintenant à une section immédiatement à l’approche de Jérusalem, autour de Jéricho.
A la suite des deux paraboles illustrant l’affirmation que « le Royaume de dieu est à l’intérieur de vous« , Luc a placé l’épisode des nouveaux-nés qu’on présente à Jésus, puis l’interrogation d’un chef sur les conditions pour obtenir la vie éternelle, aboutissant une fois de plus chez Luc à la question des richesses. Enfin, une dernière annonce de la Passion aux Douze, à la toute fin de cette montée qui avait aussi fondamentalement une visée pédagogique à leur endroit : mais ils ne comprennent toujours pas. Echec, donc, de cette pédagogie de Jésus vis-à-vis des disciples en général et des Douze en particulier : il y a de fortes chances pour qu’ils abandonnent Jésus à son sort puisqu’ils n’ont pas saisi l’exigence d’implication totale de soi, et de Jésus, et de ceux qui prétendent le suivre.
A l’approche de Jéricho, c’est d’abord un aveugle qui saisit l’occasion du passage de Jésus pour le supplier malgré ceux qui cherchent à le faire taire et qui obtient de recouvrer la vue. Et puis c’est le passage par Jéricho, où se situe notre épisode d’aujourd’hui.
Mon modeste commentaire :
« Et entrant, il traversait Jéricho. » Il ne reste pas aux abords, mais traverse résolument la ville. Jéricho est l’un des plus anciens lieux habités collectivement au monde, les archéologues ont retrouvé jusqu’à vingt strates d’établissements humains dont les plus anciens peuvent remonter à quatre-vintg-dix siècles avant Jésus-Christ. C’est aussi la ville la plus basse du monde (-240 m). Dans le récit biblique, c’est la première ville conquise par Josué au retour d’Egypte, donc un peu la porte de la Terre Promise. Autrement dit, on ne peut partir d’aussi loin dans le temps que depuis Jéricho, on ne peut partir de plus bas, on ne peut reprendre les promesses plus aux fondations.
« Et voici un homme appelé du nom de Zachée, et lui était chef des publicains et lui était riche : … » En araméen, [Zakkaïos], c’est « le juste« . Il n’est pas seulement publicain, avec toute la mauvaise réputation attachée à cette fonction, il est « archipublicain » : je n’ai pas trouvé que les publicains fussent organisés hiérarchiquement, à moins que Luc veuille faire entendre par là qu’il a acheté à ferme la collecte des impôts sur une vaste région, peut-être une province entière, et qu’il a ensuite revendu cet office par lots à des publicains sous-traitants sur des territoires moins vastes. La chose a existé, elle est évidemment fort lucrative, puisque non content de pouvoir se rembourser à discrétion sur la population des sommes versées au trésor de Rome, sur la population ou sur des sous-traitants ce qui revient au même, il reçoit encore de ces sous-traitants le prix d’achat d’une partie de son office. On comprend qu’il soit riche. Et on se demande pourquoi un tel nom ! Mais la formulation de Luc à ce sujet est lourde, littéralement « un masculin au nom appelé Zachée« , et c’est peut-être du coup un surnom ironique, un sobriquet : aux yeux de tous, il est tout sauf juste !
« … : et il cherchait à voir Jésus, qui c’était, et il ne pouvait pas depuis la foule, parce qu’il était petit par la stature. » Jésus, il en a entendu parler. Il veut le voir. Pas l’entendre, ce n’est pas là son intention : soit que cela ne l’intéresse pas, soit qu’il se dise que ce n’est pas pour lui et qu’il se pense rejeté d’avance. Il veut se faire son idée, en tous cas, et voir de ses propres yeux. Il est peut-être un bon écho de la tendance un peu « people » et « paparazzi » d’aujourd’hui : voir, cela n’engage à rien, cela ne fait pas sortir de son propre univers. La caractéristique principale du voyeur est qu’il n’interagit pas directement avec son sujet, celui-ci ignorant souvent qu’il est observé. Le voyeur, lui, en tire ce qu’il veut pour sa satisfaction personnelle. Mais là, notre bonhomme a un problème : il ne peut pas « voir » en se mêlant à la foule, non parce que celle-ci le repousserait -on ne voit personne, dans une foule, et c’est justement pourquoi s’y mêler garantit une invisibilité- mais tout simplement parce qu’il est trop petit ! Non seulement il ne verrait rien, mais on ne le verrait pas assez pour lui laisser place, il se trouverait écrasé par les mouvements de la foule, incapable d’y participer ou de les anticiper. Comment faire ?
« Et courant par avance sur le devant, il monte dans un sycomore afin de le voir, parce que celui-ci était sensé passer par là. » Malin, notre petit bonhomme : il a l’habitude de prévoir, il sait compter avec le temps. Il se doute d’un certain parcours, il trouve un moyen de se séparer de la foule et d’en surmonter l’obstacle. Etonnant : c’est la deuxième fois, dans cette nouvelle section liée à Jéricho et aux approches immédiates de Jérusalem, qu’il est question de la foule et de l’obstacle qu’elle peut constituer ! La première fois, c’est dans l’épisode inaugural de cette section, celui qui précède immédiatement le nôtre. Aux abords de la ville, un aveugle (donc quelqu’un qui, lui non plus, ne peut pas voir Jésus), apprenant que c’est Jésus qui passe à proximité, se met à crier, et ceux de la foule (ou, du moins, « ceux qui précèdent« ) le reprennent afin qu’il se taise. Il va persévérer et être guéri. On voit qu’il y a là un thème pour Luc : la rencontre avec Jésus doit être personnelle, et ceux qui sont autour de Jésus peuvent faire obstacle à la rencontre avec lui. Pas très étonnante, cette dernière réserve, quand la conclusion de toute la longue section précédente est que les disciples, y compris les Douze, n’ont toujours rien compris aux implications de leurs choix ni de leur statut (pour les Douze) !
Notre petit malin cependant, n’est pas dans la perspective de demander quoi que ce soit à Jésus : la foule est certes pour lui un obstacle, mais il ne veut pas rentrer en relation avec Jésus. Il me semble qu’aujourd’hui, il s’installerait devant son écran, qui lui garantirait sa situation de voyeur : voir sans obstacle, avec la garantie de ne pas être vu. Une différence tout de même : l’écran ne fait voir que ce que les caméras, posées et manipulées par d’autres, font voir. On croit voir ce qu’on veut, mais on voit ce que d’autres veulent que l’on voit, sans même s’en apercevoir ! Le voyeur d’aujourd’hui est asservi aux moyens dits de communication, dont personne ne dit précisément qui communique quoi à qui… Zachée, lui, fait usage de sa liberté. Il a trouvé un poste dans un arbre où, du moins, il verra de ses propres yeux, comme il le veut.  Le sycomore désigne à l’origine un figuier sycomore (c’est l’étymologie de ce nom d’arbre : [sukone], la figue, + [morone], la mûre), même s’il est plutôt pour nous un genre d’érable, voire un platane pour les anglo-saxons. Attention donc à ne pas se méprendre par un décalage de temps et de climat ! Il peut tout de même mesurer jusqu’à vingt mètres de haut, ce qui n’est tout de même pas si mal, et les feuilles sont plutôt larges (environ 14 cm x 10 cm) dans une frondaison à port étalé, ce qui outre une ombre appréciable, cache assez bien celui qui se réfugie derrière…
Le sycomore désigne à l’origine un figuier sycomore (c’est l’étymologie de ce nom d’arbre : [sukone], la figue, + [morone], la mûre), même s’il est plutôt pour nous un genre d’érable, voire un platane pour les anglo-saxons. Attention donc à ne pas se méprendre par un décalage de temps et de climat ! Il peut tout de même mesurer jusqu’à vingt mètres de haut, ce qui n’est tout de même pas si mal, et les feuilles sont plutôt larges (environ 14 cm x 10 cm) dans une frondaison à port étalé, ce qui outre une ombre appréciable, cache assez bien celui qui se réfugie derrière…
Voilà notre Zachée bien posté, bien à l’abri. « Et comme il vient sur ce lieu, Jésus levant le regard dit à son adresse : Zachée, dépêche-toi, descends ! Aujourd’hui en effet dans ta maison il faut que je demeure ! » Voilà l’inattendu : entouré d’une foule, dont on imagine le bruissement, les cris, la bousculade, les appels, Jésus lève les yeux justement à cet endroit lui parle. Et c’est bien, le texte le mentionne très clairement, à lui qu’il parle. Et il l’appelle par son nom, ou son surnom, en tous cas de telle manière que et l’intéressé et le lecteur sachent que c’est bien à lui que le discours s’adresse. « En te dépêchant, descends ! » [spéoudoo], quand il est intransitif comme ici, signifie se hâter, se presser, agir avec empressement, se donner de la peine, voire être agité ou se tourmenter. Zachée reçoit un ordre, celui de descendre, auquel il lui est demandé d’ajouter la promptitude dans l’exécution. Il doit quitter ce lieu à part, isolé, ce lieu où il reste sans interaction avec Jésus et sans être gêné, dérangé, bousculé par les autres. Ce lieu qui le place au-dessus des autres et de tous. Ce lieu où lui, le petit, s’est fait grand. La promptitude à exécuter cette injonction sera la marque qu’il consent sans discuter, qu’il a vraiment changé, qu’il a quitté intérieurement ce lieu.
Et la raison avancée : « Aujourd’hui en effet dans ta maison il faut que je demeure ! » L’urgence demandée à Zachée ne fait que répondre à une autre urgence, celle qui est au cœur de Jésus, aujourd’hui… il faut. Jésus se livre, il ouvre à celui qui voulait le voir, voir qui il est, l’intime de son cœur, son intérieur. Il dévoile un élan inattendu vers le petit malin qui se tient à l’écart : cet élan sera-t-il communicatif ? C’est un élan de l’intérieur vers l’intérieur : il ne s’agit pas d’une rencontre formelle, mais d’aller dans ta maison, chez les siens, dans son univers. Il s’agit de se compromettre avec cet archipublicain, cet homme à la mauvaise réputation. Comme s’il n’était venu que pour ça. Jésus a cette extraordinaire faculté de changer ses plans immédiatement, résolument, de tout oublier pour un seul. Et ce n’est pas en passant : [ménoo] signifie rester, se fixer, être stable, tenir bon, habiter. Ce n’est pas : « Je passe manger chez toi ce midi ! », mais bien : » Je pose mes valises chez toi, et j’y reste ! Ta maison doit devenir ma maison. »
La réaction de Zachée ne se fait pas attendre, et constitue trait pour trait un effet miroir de l’injonction de Jésus, Luc emploie exactement les mêmes mots, comme jadis le faisait l’écrivain de l’histoire d’Abraham pour montrer son obéissance point par point, sans en faire plus, sans en faire, moins, sans rien laisser tomber, sans rien rajouter : « Et se dépêchant il descend et le reçoit sous son toit en se réjouissant. » Le verbe [hupodékhomaï], qui signifie recevoir sous (son toit), signifie aussi concevoir quand il est dit absolument d’une femme. Cela montre l’implication dans l’hospitalité, et suggère à quel point on veut accueillir l’hôte dans sa pensée même, pour épouser et prévenir tous ses désirs, pour le porter en son cœur autant qu’il est possible. Et tout cela dans la joie : notre Zachée ne s’attendait à rien de tout cela, il est plus que bousculé, il est renversé dans ses projets, il ne peut plus se tenir à l’écart comme il en avait l’intention et plus encore. On devine en effet que c’était chez lui une attitude durable, une manière de se positionner dans la vie. tout cela est renversé d’un seul coup, et il a consenti par sa promptitude à ce bouleversement et du coup il est tout à la joie, qui est l’effet d’un bien présent.
« Et tous, voyant, murmurent entre eux en disant que c’est chez un homme pécheur qu’il est entré au débotté… » La foule n’en a pas fini de faire obstacle : ce sont maintenant des paroles entre eux qu’ils échangent, tous, en voyant cela. Ils ne murmurent pas contre Zachée, celui-là son compte est déjà réglé, c’est un « pécheur », un paria. Mais c’est contre Jésus qu’ils murmurent, parce qu’au moment de « dételer » ([kataluoo], c’est ici laisser tomber (les rênes)), d’en finir avec son activité, le voilà qui se contamine chez un pécheur ! Dans l’idée la plus commune, c’est toujours le mal qui contamine le bien, le pourri qui gangrène ce qui est encore bon, l’impur qui envahi ce qui est pur. Nul ne s’avise qu’en ouvrant la porte d’une pièce lumineuse sur un couloir obscur, c’est toujours un pinceau de lumière qui éclaire le couloir, jamais un pinceau de ténèbres qui envahit la pièce.
Mais voilà, Zachée est à ce point bouleversé dans sa vie, rempli de joie, attentif dans le fond de son cœur à l’hôte qui ne se contente pas de chercher chez lui un moment de repos mais qui veut rester définitivement, qu’il dissipe autant qu’il le peut ces mauvaises pensées et fait voir le pinceau de lumière dans son couloir obscur. Jésus s’est compromis pour lui, il se compromet à son tour : « Mais se levant, comme ressuscitant, Zachée dit à l’adresse du seigneur, de celui qui est désormais le maître de maison : voici, la moitié de ce que je possède, seigneur, aux pauvres je la donne !… » Il interpelle à son tour son hôte, comme Jésus l’a interpelé dans l’arbre. Rappelons-nous aussi que [ptookhos], le pauvre, signifie fondamentalement celui qui se cache, comme il était lui-même caché dans l’arbre. Il en est vraiment descendu, de cet arbre : il ne se considère plus à part, mais il veut vivre activement en solidarité. Et il continue : « …et si j’ai extorqué frauduleusement quelque chose à quelqu’un, je rends quatre fois plus ! » Là, on n’est plus seulement dans le partage, on est dans la réparation de torts causés, et de notoriété publique. Le « si » n’est pas une condition irréelle, j’aurais pu traduire « dans la mesure où… » Le verbe est [sukophantaoo], qui donne nos sycophantes : il s’agit de faire métier de calomniateur, d’imaginer des accusations fausses mais plausibles, en sorte de faire condamner des gens en justice, à moins qu’ils ne s’acquittent d’une rançon. Terribles machinations qui ne peuvent que laisser des souvenirs cruels et amers, sans compter qu’elles réduisent souvent leurs sujets à la misère. Le nouveau Zachée, avec la moitié de biens qui lui reste, va plus qu’indemniser, il va rendre quatre fois ce qu’il extorqué. On se dit qu’il ne va pas lui rester grand chose… Manifestement, ce n’est plus son souci, il a trouvé un autre trésor qui seul compte pour lui. En tous cas, il y a de quoi faire taire les murmures au sujet de Jésus : non, il ne loge pas chez un « pécheur », ce n’est plus un « pécheur ».
« Jésus dit à son adresse : aujourd’hui le salut est advenu à cette maison, puisque lui aussi est fils d’Abraham. En effet le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » C’est le même aujourd’hui que tout à l’heure, et pas tout-à-fait cependant. Le même, parce qu’avec l’entrée de Jésus chez lui est entré un salut. Pas tout-à-fait, parce que l’entrée s’est faite par le prompt consentement de Zachée, et non sur la seule injonction de Jésus : il y a eu sa promptitude, il y a eu sa joie. Et c’est en cela qu’il est fils d’Abraham : il a montré la même foi, la même correspondance, la même image, le même reflet dans sa vie , devant la volonté qui se dévoilait à lui. Il a tout compté pour rien, tout ce qui auparavant comptait pour lui (et il comptait, c’était son métier !), au prix d’accueillir pour qu’il demeure son hôte inattendu. On devine un peu ce que Luc appelle ici « salut » : Zachée était dans un monde auto-référencé, dont il était le centre, un monde où lui seul comptait (dans tous les sens du terme). Le voilà désormais avec une autre échelle de valeurs, une autre référence, arraché à lui-même mais mis dans la joie. Il ne profite plus des autres, il ne vit plus comme un vampire à leurs dépens, il est la demeure de la lumière, tout ouvert, dans le partage et aussi la réparation (marque de réalisme, on ne fait pas fi du passé mais on l’assume courageusement). Quelle descente vers le haut !