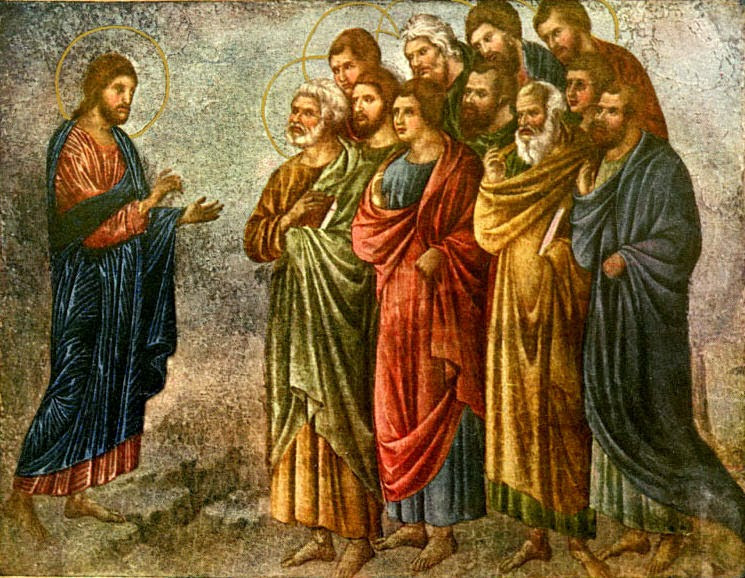Lire le texte de l’évangile sur le site de l’AELF
Nous continuons le lecture du témoignage de Marc. Jésus a migré en bateau jusqu’à la Décapole, « au pays des Géraséniens« , une zone qui ne fait pas partie d’Israël. Il y a bien guéri un possédé, mais les habitants effrayés l’ont suppliés de s’en aller : ils n’ont pas vu que le migrant fait du bien, ils sont juste restés sur leur peur et l’ont chassé. Voici maintenant un tout autre épisode qui se présente comme un triptyque, disposition littéraire que Marc tient en particulière affection. Au centre du triptyque, la guérison d’une femme hémorroïsse. Autour, en deux volets, le récit de la résurrection d’une jeune fille de douze ans.
Pourquoi une telle construction ici ? Car les deux volets extérieurs sont un seul récit, de sorte que l’ensemble ressort plutôt comme un récit enchâssé dans un autre. Pourquoi ne pas raconter une chose puis l’autre ? C’est sans doute que Marc tient à ce que son lecteur crée des rapports entre ces deux récits. Dans les deux cas il s’agit d’un guérison, et même d’une résurrection dans le deuxième cas. Dans les deux cas c’est par un toucher. Dans les deux cas aussi, le succès est une question de foi : « Fille, ta foi t’a sauvée » dit Jésus à la femme. « Ne crains pas, crois seulement. » dit-il au père de la jeune fille. Mais il y a aussi une série de contrastes : la femme est au milieu de la foule, quand Jésus renvoie presque tout le monde d’autour de la petite fille. La femme va à Jésus, et à son insu à lui, quand c’est Jésus qui va à la jeune fille, et à son insu à elle (forcément puisqu’elle est morte). Ces rapports nous font peut-être apercevoir ce qui est important dans l’ensemble du récit. Il me semble que ce qui est raconté au centre, ce récit de la femme qui approche de Jésus et obtient par sa foi sa guérison, est comme un commentaire ou une extension à tous de ce qui est fait dans le récit-cadre de la résurrection. Car au fond, toutes deux sont finalement relevées. Autrement dit, chacun peut, comme la femme, en s’approchant de Jésus et quelle que soit la « qualité » de sa foi, obtenir de lui ce qu’il offre à la jeune fille morte : la guérison et la vie.
Je voudrais du coup m’attacher plutôt à cette jeune fille. A cause peut-être de ce que dit son père : « Ma fillette est aux extrémités, pour qu’en venant tu lui imposes les mains, pour qu’elle soit sauvée et vive !« . Il est vraiment éploré, ce père, il est très touchant. La manière dont il parle, impossible à écrire, sent l’expression orale rapportée par l’auditeur, avec la confusion qui lui et propre, avec l’insistance aussi. Il est pourtant « archisynagogaire », un chef de la synagogue, un notable. Mais il tombe aux pieds de Jésus devant toute la foule, il oublie toute dignité, il n’a pas plus de respect pour soi ou de souci de son image, il est pris par une autre urgence devant laquelle tout cède. Il est préoccupé par sa fille, sa « petite fille« , non pas au sens où il serait son grand-père (ce serait une autre dénomination en grec), mais au sens où il l’aime. C’est le diminutif que l’on donne spontanément à ce qu’on aime. Petite, parce qu’on l’a dans le cœur; mais grande, au vu de la place qu’elle y tient. Elle est, cette petite chérie, aux extrémités : [eskhatos] c’est l’extrême, c’est aussi ce qui arrive en dernier. C’est ce qui est le plus loin, le sommet ou le fond, c’est le dernier degré. Voilà où en est celle qu’il aime. Combien d’enfants ou de jeunes qui nous tiennent à cœur et qui sont dans l’extrême. Dans leur vocabulaire même, ils sont à l’extrême, et même au-delà, à l’excès… Tous ces enfants et ces jeunes auxquels nous tenons et qui nous paraissent toucher le fond, ou à qui il vient d’arriver quelque chose en dernier, ou qui sont « les derniers » et les laissés pour compte. Et le désir de ce père éploré : il veut un geste, un geste de transmission et de protection tant de fois répété dans la bible, un geste même qui traverse tant de civilisations. Un geste de la main, un simple contact, un toucher volontaire. Et il attend tellement de ce geste : rien moins que la santé et la vie ! Cette jeune fillette, ce sont tous les jeunes et les enfants qui font frémir et trembler nos cœurs. Ce cri d’un père oublieux de tout lui-même, c’est notre souci de ces enfants que nous aimons.

Jésus y va, « et il s’en va de là avec lui. » Il cesse ce qu’il faisait pour cette petite fille et pour ce père. Il est maintenant avec lui. Viennent à leur encontre on ne sait qui, mais qui portent une mauvaise nouvelle : « Ta fille est morte. » Annonce brutale et sans ménagement. Ce n’est plus la « petite fille » chérie, c’est juste sa « fille » et elle est morte. Le père a gaspillé son temps à venir chercher Jésus, à s’adresser à lui. Il a perdu les derniers moments qu’il aurait pu vivre avec la petite fille de son cœur. Sa prière n’était que perte de temps. « Pourquoi fatigues-tu encore le maître ? » ajoutent-ils dans leur brutalité. [skullô], c’est d’abord écorcher, déchirer, c’est ensuite arracher les cheveux, tourmenter et de là fatiguer. Ce que probablement ce père ne va pas tarder à faire sur lui-même au sens propre, ils lui reprochent de le faire vis-à-vis de Jésus au sens figuré. Mais c’est comme une invitation à ne pas sortir de ses propres douleurs : ne va pas affliger les autres de tes propres afflictions, assume ton malheur, garde-le pour toi. Et combien de fois avons-nous peine à parler, à exprimer à partager les tourments qui sont les nôtres au sujets des enfants qui nous sont chers ? C’est si profond qu’il y a comme une peur de les dire, comme une honte aussi. On veut tellement être fiers de ses enfants, comment pourrait-on redire, manifester ce qui nous fait peur à leur sujet ?
Mais Jésus a intercepté ces mots et les siens sont radicaux à leur tour : « N’aie pas peur, seulement crois.« . Peut-on renoncer à ses peurs ? Et surtout quand elles sont aussi viscérales, aussi congénitales ? N’a-t-on pas peur plus pour ses enfants que pour soi-même ? Mais le verbe [fobéô] dit d’abord et fondamentalement « mettre en fuite » : il me semble que c’est cela qui est interdit. Ne pas fuir à cause de ce qui menace ou atteint nos enfants, ne pas se laisser aller comme une armée en déroute, dispersée partout, impossible à réunir et rassembler. Ne pas se désunir, se rassembler au contraire. Se ramasser, comme pour mieux bondir. Rassembler ses forces, ses énergies, ce que l’on sait. Ne pas fuir non plus devant ce que l’on sait de la situation. Voilà les faiblesses auxquelles ma fille, mon petit-fils, mon élève, mon jeune ami, doit faire face. Voilà les mauvais appui qui sont les siens, voilà les périls qu’il traverse. Ne pas fuir, ne pas se masquer les choses derrière des « ça va aller » trompeurs, ne pas refuser de nommer les choses. Et avoir confiance, « seulement, crois« . Croire en eux d’abord, à ce qu’ils portent en eux, à l’énergie qui les habite. A leur lucidité dans ce monde sur les personnes qui les entoure. A leur capacité de faire confiance. Et croire en celui qui les aime plus encore que nous. Et c’est ici que Jésus fait le vide, se sépare de la foule. Pour entrer dans cette attitude, il faut quitter le tumulte et la bousculade. Pas de slogans, pas de formules toutes faites, mais un retour à soi et à son amour pour envisager les choses et les situations comme elles sont, la personne -l’enfant chéri- comme elle est.
Les voilà qui arrivent à la maison du pauvre père. On ne rentre en soi, dans sa maison, qu’une fois écartée la foule exaltée ou vibrante. Et là sont le tumulte, [thorubos], la clameur confuse et le trouble. Affronter cela en rentrant chez soi, en rentrant en soi. Cela aussi il va falloir l’écarter. Et ce n’est pas seulement ce tumulte, c’est encore « celles qui pleurent et celles qui poussent des allalas« . Qui ne connaît ces cris poussés au Moyen-Orient à l’occasion d’un deuil, ces cris stridents et entêtants. Dans la maison, il y a aussi cela, un cri jeté et lancinant, un sanglot permanent, devant le malheur promis. Envie de pleurer, envie de hurler. Mon enfant. Tout cela aussi, il va falloir le mettre dehors, et même le jeter dehors avec énergie -et il en faut pour dépasser cela. Et comment faire ? La question du pourquoi d’abord : « Pourquoi vous agiter et pleurer ? » Se dire le pourquoi. Se dire que c’est à cause de l’amour. Se dire aussi les autres raisons, le trouble et l’ombre jetés sur notre propre vie, sur nos espérances. Se dire tout ce qui se passe en nous, tout ce qui remue. C’est en mettant des mots sur nos sentiments qu’on les dépasse. On ne les élimine pas, c’est impossible : mais on peut les pousser de côté, on peut passer. On peut ne pas s’arrêter à soi -car c’est cela, le trouble et les pleurs- mais aller jusqu’à celle qu’on aime, à la toucher. Et puis une affirmation : « L’enfant n’est pas morte mais dort. » : ce mot est d’abord un écran de fumée, qui prépare la défense que Jésus fera aux parents de raconter quoi que ce soit. Pour ceux qui ne restent pas, il faudra malgré leurs moqueries du moments se rendre à l’évidence : il avait raison, elle n’était pas morte puisque nous la voyons à nouveau vivante. Et nul ne saura le drame vrai, non plus que la merveille indicible. Mais il y a aussi comme une profession de foi de Jésus : cet enfant que tu aimes, tout n’est pas mort en lui ou en elle. Il y a toujours la vie qui sommeille, il faut juste la réveiller. C’est un autre point de vue sur cet enfant chéri qui nous cause tant de souci , de trouble, de cri intérieur. La vie sommeille. Regarde-là. Regarde la vie en elle. Cherche la vie en elle, cherche ce qui est là, crois-y aussi.
Et puis les moments décisifs, après toutes ces traversées : « il pénètre où était l’enfant« . Pas tout seul : avec le père et la mère, et ceux qui l’accompagnent. C’est un chemin ultime qu’on ne peut faire seul. Et prier Jésus ne veut pas dire le laisser faire seul : il faut pénétrer avec lui, impossible de rester en arrière. Entrer dans le cœur, dans ce lieu où est l’enfant. Où était l’enfant : car le drame fait qu’il ne se trouve plus là, ou plus de la même manière. Il échappe. « Et tenant la main de l’enfant il lui dit : talitha koum, ce qui est en traduisant : jeune fille, je te le dis, éveille-toi. » Prendre la main, c’est toucher, c’est aussi conduire. C’est montrer qu’on est avec. Un geste tout simple de solidarité indéfectible. Je marche avec toi, où que tu ailles. Et il l’appelle d’un terme familier, pas le mot de « fille » employé par les annonciateurs de mauvaise nouvelle, pas non plus le mot de tendresse de « petite fille » employé par le père, un autre encore, qui dit la familiarité, la proximité, la complicité. D’un mot, il s’est mis à son niveau, à sa hauteur. Ce qui compte, c’est qu’elle sache qu’on est à sa hauteur, à sa portée. Avec elle, décidément. Et plus précisément encore : je te le dis ou « c’est à toi que je parle » : une parole juste pour elle, du cœur au cœur. Et cette parole, [égéïré]. [Egéïrô], c’est s’éveiller, c’est aussi, être éveillé, être vigilant, c’est encore se lever. Parole de confiance communiquée : en toi dors ceci, ou cela. Je l’ai vu, je te le dis. Et j’appelle en toi cette dimension à l’éveil ou au réveil. Et c’est toi tout entière qui peut te lever, qui peut te relever. Il ne sauve pas en la faisant lever de la force de sa main. Il lui prend sa main pour lui donner confiance, et c’est elle qui va faire, c’est elle qui va se réveiller et se lever c’est elle qui va « se sauver ». Là est la foi mise en elle. La est la foi dont ont besoin les jeunes et les enfants.
« Et aussitôt« , l’effet est immédiat, « se lève la jeune fille et elle marche; elle avait en effet douze ans. » petite précision : c’est une jeune, elle avait déjà appris à marcher, et c’est pourquoi elle peut le faire et même elle doit le faire. Elle est rendue à toutes ses facultés, elle n’a rien perdu. Elle n’a pas non plus acquis des « super-pouvoirs », elle est rendue à elle-même. « Et aussitôt ils sont extasiés d’une grande extase. » C’est la stupeur, mais pas la peur, non : c’est l’extase, c’est-à-dire la sortie de soi vers l’autre. Leur émerveillement n’est pas de ceux qui renvoient à soi : ils sont entraînés vers elle. Pas de reproche, pas de retrait, rien qui commence par « re-« . On ne recommence rien, c’est nouveau. Il faut sortir vers la nouvelle fillette, vers le nouvel enfant. « Et il leur recommande beaucoup de ne faire savoir cela à personne« , ça, c’est pour préserver son secret, « et il dit qu’il lui soit donné à manger. » Ça, c’est pour rétablir entièrement les relations, les fonctions de chacun. Les parents restent parents, ils ont toujours leur service à assurer, la croissance n’est pas finie, la vie doit toujours être soutenue…