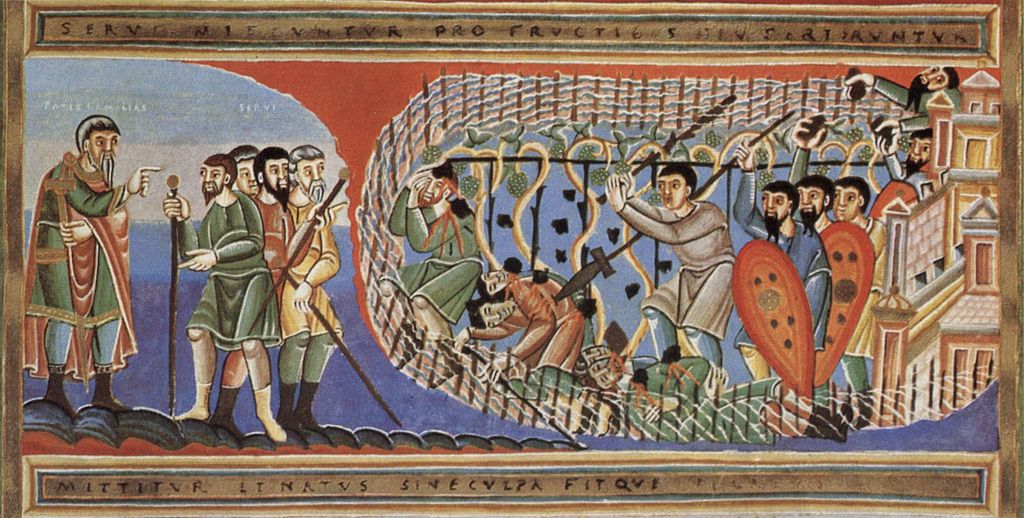Le texte de l’évangile, sur le site de l’AELF.
Voici qu’après avoir été mis à l’épreuve par ses interlocuteurs, Pharisiens et prêtres, Jésus les a fait taire. Et il s’adresse maintenant aux foules et leur parle de leurs chefs. J’ai essayé de montrer déjà, dans ce texte, quelle attitude il suppose de notre part à l’égard des Ecritures : une écoute attentive et une recherche personnelle pour les traduire dans notre vie, avec une confiance faite à l’Esprit qui nous a été donné, Nous avons tous de quoi changer le monde. Mais je voudrais cette fois m’attarder sur l’attitude qu’il suppose à l’égard des responsables.
Il a cette phrase inaugurale : « Toutes les choses, donc, s’ils vous les disent : faites et gardez ; selon leurs agissements cependant ne faites pas -car ils disent et ne font pas. » Et le reste de ce long discours, dont nous n’avons que le début, sera véritablement à charge contre les pharisiens et les scribes, avec pas moins de sept « malheur à vous » en les qualifiant d’ « hypocrites » (sauf une fois, où ils sont « guides aveugles« ). Ils sont donc situés comme des relais verbaux, mais non comme des références de vie.
Je dois avouer que je suis assez fâché (une fois de plus, me direz vous) que les auteurs du lectionnaire ne nous donnent pas la totalité de ce discours, qui a pour but de permettre aux auditeurs une distance critique, d’autant plus importante dans l’intention de l’évangéliste qu’il y revient sept fois, nombre si symbolique, et d’autant plus précise qu’elle est détaillée sur plusieurs agissements, attitudes ou points de vue. Or l’actualité brûlante nous fait voir à quel point cette distance critique est nécessaire !
Je dis bien « nécessaire », pas seulement utile. Oui elle est utile, quand chaque semaine nous apporte son lot de manquements parfois très graves (parfois moins) des responsables religieux. Mais pour avoir une telle place dans l’évangile, il faut que cette attitude soit partie de l’attitude de foi que l’évangéliste tient à nous transmettre. Il le dit d’ailleurs d’une manière positive, « Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ« , autrement dit : c’est lui seul qu’il faut suivre et imiter. Toute autre imitation blesse la foi elle-même. Nous avons tous des personnes que nous admirons, pour des raisons très défendables et justes. Et pourtant la foi nous impose ce renoncement : n’imiter que le Christ, et personne d’autre.

Certains adages sont à cet égard choquant, ou du moins devraient l’être si nous étions d’authentiques croyants, et s’ils ne nous choquent plus, c’est un indice qu’il y a quelque chose à reprendre dans notre manière de croire. Par exemple, le fait que nous appelions si facilement « père » des frères dont la fonction est justement de… nous transmettre authentiquement la parole ! Et si facilement ceux-ci se laissent faire, voire y invitent. (J’avoue qu’il m’arrivait de laisser faire, dans le ministère, mais combien je préférais qu’on m’appelle simplement pas mon prénom, c’est tellement suffisant ! Avons-nous besoin d’autre chose que de savoir clairement à qui on s’adresse ?). Cela se traduit souvent par le fait de ne demander conseil pour sa vie qu’au seul prêtre : mais plus nous aurons de voix, plus nous serons aidés à entendre ce que l’Esprit nous dit au cœur et à décider ce que nous allons faire ! S’en tenir à un seul avis, s’y conformer en tout point, n’est pas évangélique. C’est renoncer à chercher soi-même, au fond renoncer à être un disciple, en croyant l’être plus entièrement.
Par exemple, l’adage qui veut que « le prêtre [soit] un autre Christ » : eh bien non ! Justement pas ! Car il n’y en pas d’autre. Comment ! Le magistère ecclésiastique ne dit-il pas depuis le concile de Trente que le prêtre, quand il célèbre, agit « in persona Christi » ? Ma foi, la référence n’est plus ici directement à l’évangile, mais admettons. Et constatons qu’il a fallu corriger la formule dans les documents d’un autre concile (Vatican II) en « in persona Christi capitis« , en la personne du Christ-tête. Et pourquoi ? Parce que dans la même célébration, toute l’assemblée agit aussi en la personne du Christ-corps. C’est l’unique et seul Christ qui agit partout et en tous. Les fonctions sont distinctes, mais là s’arrête la distinction. Et elle ne vaut que dans le cadre symbolique d’une célébration, où se déploie dans l’ordre du signe (qui a donc besoin de contrastes, de variété) l’unité essentielle du mystère. Dans le cadre de cette même célébration, quand quelqu’un prêche, que les autres écoutent activement (en réfléchissant, en cherchant à comprendre, en pensant éventuellement autre chose que le prédicateur au sujet de tel ou tel commentaire de la parole, en voyant comment conformer sa vie à la parole reçue, etc.), se joue la même distinction : elle n’est que fonctionnelle, car le prédicateur doit lui aussi écouter la parole et en changer sa vie, et l’auditeur en l’écoutant activement devient en quelque sorte son propre prédicateur !
Par exemple encore, le fait que le pape lui-même soit appelé « vicaire du Christ ». Pendant bien longtemps, le titre était « vicaire de Pierre« , indiquant ainsi que sa fonction était de tenir la place (en partie au moins) qu’avait tenue Pierre. Et puis au Moyen-Âge, dans la suite de la réforme de Grégoire VII cherchant à assoir l’autorité du pape plus haut que celle des rois et de l’empereur, Innocent III a changé ce titre en « vicaire du Christ« . On change de registre, nettement : il ne s’agit plus de tenir la place du disciple, mais bien du Maître !! C’est une prétention hallucinante, quand on y réfléchit un instant. Mais qui en est choqué ?! Eh bien nous devrions ! Et au nom de notre foi, pas moins, puisque c’est l’évangile lui-même qui nous demande de ne jamais mettre sur le même pied le Christ avec aucun de ses disciples.
L’évangile nous dit donc : « Toutes les choses, donc, s’ils vous les disent : faites et gardez ; selon leurs agissements cependant ne faites pas -car ils disent et ne font pas. » Les autorités religieuses sont bel et bien à respecter, car leur fonction essentielle et première est bien de transmettre la parole. Et c’est la parole qui est l’objet de vénération : si le dieu consent à nous parler, l’attitude de foi est dans son fondement même une écoute de cette parole, une recherche de cette parole. Mais la distinction que fait Matthieu est capitale. L’autorité de la parole pour le croyant ne se confond pas avec une autorité de celui qui la transmet. Bien au contraire, la gratitude et le respect pour ceux qui la transmettent ne se transforme jamais en autorité de ceux qui la transmettent. Cette confusion est toujours au détriment de la parole, c’est pourquoi elle blesse la foi. La parole, il faut chercher à l’entendre, à la comprendre, à l’assimiler (c’est-à-dire à lui devenir semblable, pas moins). Or cette parole est vivante, elle est créatrice de ma différence, de ma personne, elle s’inscrit dans mon histoire, elle ne peut le faire comme dans l’histoire d’un autre. Pas d’autre modèle, donc, que le seul Christ, qui est le seul « universel concret ». Et le rejet des autres modèles, aussi grands, aussi saints soient-ils, est nécessaire pour être comme après la transfiguration « avec Jésus seul« .
Maintenant, cette distance critique vis-à-vis de ceux qui transmettent la parole est en fait vitale pour le collectif, pour la vie de la communauté. C’est l’attente et la soif de la parole de la part des auditeurs qui tire le meilleur de ceux qui la transmettent. Mais aussi, c’est l’exigence et la réception collective de la parole qui édifie la communauté. Quand je dis collective, je ne veux pas dire le compromis plus ou moins a minima sur lequel on s’est accordé : ainsi, quand par exemple pour le synode en cours, bien des demandes de fidèles ont été écartées des synthèses diocésaines sous prétexte qu’elles étaient « minoritaires », ce n’est pas une réception « collective » de la parole. Mais ce que chacun entend à partir de son point de vue, ce qui est original, ce qui ne ressemble pas à ce qu’entend un autre, c’est cela-même qui constitue le bien collectif : ce qui n’a pas encore été dit, compris, déployé, de la parole.
Ainsi, si l’on déplore que la construction de l’Eglise ne soit pas en tous points conforme à la parole évangélique, ce n’est pas seulement « la faute » des responsables qui auraient « pris le pouvoir ». C’est bien une responsabilité collective de tous ceux qui ont laissé faire, c’est un attiédissement de la foi de tous ceux qui n’ont pas dit ce qu’ils entendaient dans la parole qu’on leur transmettait. Il ne faut pas laisser seuls les transmetteurs de la parole, il ne faut pas les laisser avec un « pouvoir » qui se constitue par le fait-même, et dont ils croient après être chargés -et c’est lourd ! « et tous vous êtes frères. » Nous sommes gardiens les uns des autres, gardiens aussi des responsables, dussions-nous leur crier ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre. Et aller peut-être jusqu’à leur « tenir tête » pour pouvoir « faire corps » avec eux, c’est peut-être bien dans la vie ordinaire être aussi à son tour le Christ-tête pour former son corps.