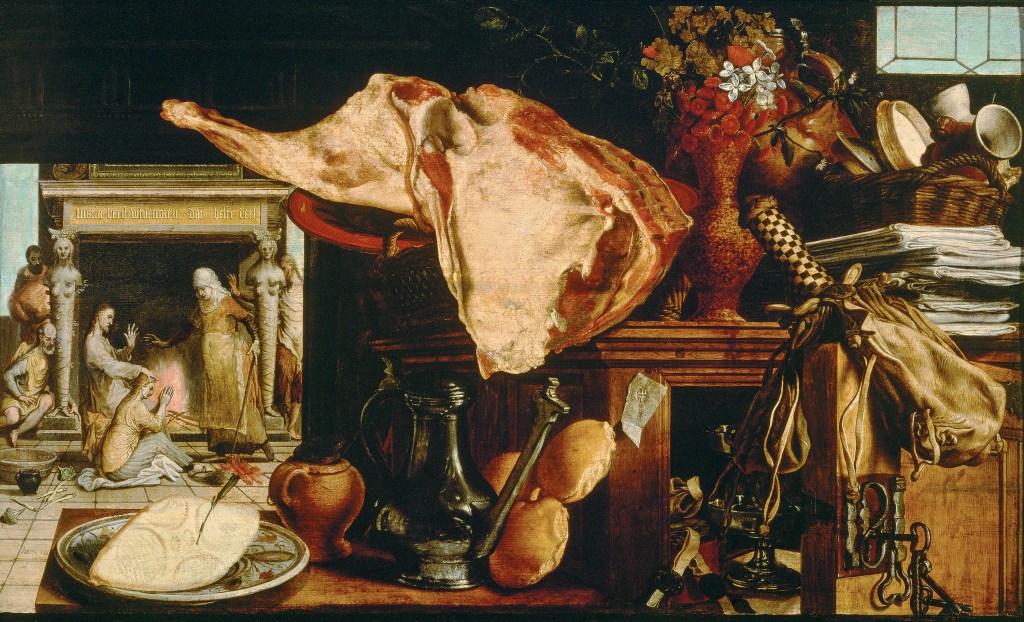Le texte de l’évangile, sur le site de l’AELF.
Le texte d’aujourd’hui, à deux versets près, fait suite à celui de la semaine dernière. Il faudrait d’ailleurs plus justement dire LES textes d’aujourd’hui, car en fait il y en a deux, l’un sur le couple et le mariage, l’autre sur l’accueil du royaume comparé à celui des enfants. Je l’ai déjà commenté en son entier, en essayant de montrer l’insistance qui s’y trouve développée à propos de la convergence des volontés.
Je voudrais cette fois m’arrêter plus spécialement sur le premier d’entre eux, sans autre motif que les pensées qui me sont venues en y réfléchissant. Je me suis demandé un bon moment si je ne devais pas plutôt m’attacher au second, du fait de la publication en France, la semaine qui vient, du rapport Sauvé : réfléchir sur « accueillir le royaume comme un enfant » au moment de la publication d’un rapport sur les abus sexuels sur mineurs dans le clergé pouvait avoir une pertinence. Mais je me dis que je voudrais prendre d’abord connaissance de ce rapport plutôt que d’anticiper…
Je suis d’abord frappé par le contexte : Jésus fait le détour aux frontières du pays, il fait tout pour ne pas embarrasser les autorités religieuses. Mais ce sont les Pharisiens qui, loin de fermer les yeux, vont le trouver sur les frontières et l’interrogent dans le but avoué de trouver dans ses paroles de quoi lui faire un procès. Ce contraste est saisissant. Quel acharnement ! Mais c’est l’autorité sur le peuple qui est en jeu : Jésus rassemble des foules considérables, qui se déplacent même jusqu’aux frontières pour l’entendre. Les Pharisiens et les autorités religieuses voient bien qu’elles risquent de se faire « voler » l’autorité ; tant qu’elles en ont encore une, il leur faut réagir et en profiter pour le faire juger et condamner -et ainsi ré-asseoir leur autorité, la manifester comme suffisamment légitime et autorisée pour juger de la valeur ou non des doctrines professées par ce prédicateur itinérant.
Et le dialogue s’engage, sur une « peau de banane » jetée sous ses pieds. On l’engage à juger la loi : quelle que soit la position prise, elle sera en porte-à-faux, puisque la loi exige d’abord qu’on se soumette à elle… Il ne s’y trompe pas, et leur renvoie immédiatement la question : « que vous a commandé Moïse ? » C’est éviter d’emblée le piège. On se met à l’écoute de la loi.
Mais il a plusieurs façons de comprendre ce « Moïse ». La question, la référence, à nos oreilles contemporaines, nous oriente vers ce haut personnage, et du coup vers les passages de l’Exode, du Lévitique, des Nombres ou du Deutéronome, en lesquels nous voyons le personnage de Moïse à l’action, de sa naissance à sa mort, et en lesquels un certain nombre de paroles ou de prescriptions lui sont attribuées. Mais aux oreilles des personnages de notre texte, le renvoi est beaucoup plus large : « Moïse », c’est le plus gros tiers des Ecritures. C’est tout ce qui reste si l’on retire les Prophètes et ce que nous appelons les écrits de sagesse (psaumes, proverbes, etc.). Les pharisiens en particulier accordent une autorité à tous ces écrits, depuis la Genèse jusqu’à Judith. Pour eux, Moïse, le plus grand des prophètes, les a rédigés.
Pourtant, ils ne prennent pas la vision large, ils ne cherchent pas la synthèse de ce qui se dit du couple dans tout cet ensemble, mais s’en tiennent à une mini-prescription, celle qui dit comment s’y prendre pour une répudiation : il faut un acte écrit préalable.
La manière dont Jésus revient à la vision large est, je trouve, particulièrement frappante : « En raison de votre durcissement-du-cœur a-t-il écrit pour vous cette prescription. » Ainsi donc, il y a différents « niveaux » dans la loi (ou plus largement dans les écrits « de Moïse ») : il y a des éléments qui dévoilent le projet du créateur, et il y a des éléments circonstanciels, des éléments dont le but est plutôt de réguler la vie dès lors que les hommes sont ce qu’ils sont, dont le but est sans doute d’empêcher que les maux n’entraînent des maux plus grands encore. Tout n’est donc pas à mettre au même niveau dans les écrits, puisque certaines dispositions sont ad hominem.
La [sklèrokardia] est mot-à-mot l’induration du cœur. C’est le même mot qui se trouve dans la finale de l’évangile de Marc pour caractériser l’incrédulité des disciples à l’endroit des témoins de la résurrection. Je ne peux m’empêcher de penser à ce passage d’Ezéchiel : « J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » (Ez.36,26). Le cœur peut devenir dur, sclérosé, jusqu’à se muer en pierre. Mais la promesse, l’espérance, est de ne pas en rester là, mais que la vie reprenne le dessus. Que le cœur se remette à battre, à ressentir, à diffuser le sang et la vie. Le cœur, c’est dans l’être humain le siège des sentiments mais aussi de la réflexion et des décisions. Par-dessus tout, le cœur est le lieu de l’écoute, l’organe de la rencontre avec le dieu.
L’induration du cœur conduit forcément à des catastrophes dans le couple : plus de ressenti, plus de décisions, plus de réflexion, plus d’écoute. Comment ne pas en venir à renvoyer l’autre si on n’écoute plus ? Je ne parle pas seulement d’écouter celui ou celle que j’aime, mais aussi d’écouter ce qui se passe en moi dans nos relations et notre vie ensemble : l’écoute est, ce me semble, une activité totale qui s’exerce dans une interaction et a aussi cette même interaction pour objet. Et quand j’écris cela, je vois bien mes déficiences ! Mais je sens bien tout de même que sans cette écoute, le ressenti n’est plus que partiel ou atrophié, la réflexion pour construire le couple n’est plus appuyée dans le réel, les décisions deviennent inconsistantes et bientôt on n’en prend même plus sinon celles qui nous concernent tout seul. On s’éloigne bientôt comme des icebergs à la dérive… Quand on en est à ce point, mieux vaut sans doute rendre sa liberté à l’autre, en la garantissant par un écrit, que de faire encore plus de dégâts en écrasant l’autre sous le poids de mon égoïsme ou de mon égocentrisme.
Et il va se référer non à un précepte de Moïse mais à ce que « Moïse » écrit sur la création : une parole fondamentale plutôt qu’une parole ad hominem. « à partir du commencement de la creation, mâle et femelle il les fit ; à cause de cela l’être humain quittera son père et sa mere, et ces deux seront pour une chair une. » Plutôt que de partir d’un cœur endurci, mieux vaut partir du cœur à l’état natif. Repartir de ce que nous sommes dans nos commencements, repartir de nos premières intentions, de nos premiers mouvements, de nos premiers élans. Nous pouvons tous le faire, moyennant un petit retour sur soi. Nous pouvons le faire pour réparer une situation dégradée, nous pouvons le faire pour affronter une nouvelle situation qui déséquilibre l’ordre patiemment construit, nous pouvons le faire pour ne pas risquer trop l’induration.

Et dans ces fondements, dans cette « création » ([ktisis], c’est le mot réservé à l’action divine qui tire du néant à partir de rien), dans ce retour à ce commencement « à partir de rien », dans ce retour à cette rencontre qui aurait pu ne jamais se produire, à ces sentiments inconnus qui sont nés, à ces événements que nous avons vécus sans les maîtriser, retrouvons ce qui dès le début nous différenciait. « mâle et femelle » : ce qui nous fait autre, depuis le début.
A ce point, nous retrouvons notre élan natif, notre motivation dans sa source. Ce qui nous a fait chacun « partir », démarrer, « à cause de cela l’être humain quittera son père et sa mere, et ces deux seront pour une chair une. » Ce démarrage, cette immense aventure à deux, a été une vraie réorientation de vie. Nous n’avons plus été orientés vers notre origine, vers ceux dont nous venons, mais nous nous sommes tournés vers un avenir ouvert et à inventer, vers une réalité dans laquelle entrer, et dont l’enfant (une seule chair) est le symbole autant qu’une partie de la réalisation. Dans cette chair une, bien plus vaste que les seuls enfants qui l’incarnent pourtant, dans cette chair une qui est toute la réalité de notre union, dans cette chair une il y a un cœur de chair. Et c’est lui qui bat, c’est lui qui peut sans cesse donner vie.
Et c’est à partir de ce cœur de chair qu’encore aujourd’hui et comme au premier jour, nous pouvons reprendre un chemin d’union, un chemin ensemble, et ne pas nous poser en « régions distinctes ». « Ce que dieu a mis-ensemble-sous-le-joug, que l’être humain n’en-fasse-pas-deux-pays-étrangers« . [khooridzoo], est bien séparer, mais le verbe vient nettement de [khoorion], le pays, la région, dans ce qu’elle a de distinct. Je dis cela pour justifier ma traduction un peu bizarre ! Mais on voit bien les deux dynamiques. La bonne nouvelle, l’évangile d’aujourd’hui, c’est bien que nous avons toujours ce cœur de chair à partir duquel aller vers l’union jamais achevée.