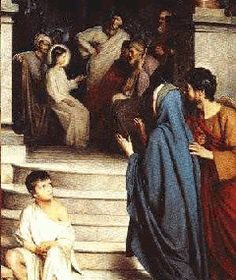Le texte de l’évangile, sur le site de l’AELF.
J’ai déjà commenté ce texte sous le lien suivant : Disciple, mais pas pour soi. Je voudrais revenir cette fois sur l’aspect original et, disons-le, curieux, de ces béatitudes de Luc.
Les béatitudes, nous les connaissons surtout chez Matthieu. C’est un texte célèbre (Mt.5,1-12) et fait pour l’être ! Il est en effet remarquablement construit, avec un refrain, un rythme, des parallélismes : un texte écrit pour être retenu facilement par cœur quasiment à première lecture. A vrai dire, il a même tous les indices d’un texte avant tout dit et dit pour être retenu, puis retranscrit par écrit. Matthieu nous rapporte huit béatitudes, plus une neuvième. Les huit sont adressées à tous en général, alors que la neuvième ne concerne que certains auditeurs présents (« vous« ). Elles ont toutes une forme paradoxale qui, au fond, invite chacun de ceux qui vit une situation a priori de souffrance ou d’infériorité à l’envisager autrement, et en énonçant une ouverture permettant cet autre regard. Qui plus est, Matthieu place ces béatitudes en tête du « discours sur la montagne », discours inaugural de Jésus dans son ministère qui évoque comme une loi nouvelle donnée sur la montagne par le nouveau Moïse. C’est en général tout cela que nous avons en tête lorsque nous pensons « béatitudes ».

Le texte de Luc, qui nous est donné ce dimanche, ne se présente pas du tout de la même manière. Il est presque abusif de l’appeler « béatitudes », parce que ces huit paroles comptent autant de bénédictions (quatre) que de malédictions (quatre aussi). L’ensemble est énoncé dans un autre contexte, que bien sûr nous n’avons pas parce que le lectionnaire nous a fait sauter joyeusement à travers le livre de Luc, et qu’il supprime allègrement les versets 18 et 19 (jugeant sans doute que Luc est un bavard qui aurait pu faire plus simple et ne pas nous encombrer avec tant de paroles inutiles !!) : Jésus vient de choisir douze d’entre ses disciples et de les nommer « apôtres« . Loin de rester sur la montagne où s’est dans la prière effectué ce choix, il descend dans la plaine retrouver « la foule nombreuse de ses disciples » et « la multitude nombreuse du peuple » qui sont venus « l’écouter et être guéris de leurs maladies » : Luc est souvent attentifs aux différents groupes, et là il y a nettement deux groupes distincts, celui, nombreux, des disciples et celui, encore plus nombreux, du peuple. Et ce mot de « peuple« , [laos], désigne traditionnellement le « peuple de dieu », le peuple juif, par distinction des « nations ». Nous retrouvons la présence d’un noyau (les disciples) de renouvellement du peuple entier (le peuple).
Notons bien que, descendant dans la plaine, la scène n’évoque pas comme chez Matthieu celle d’une « loi nouvelle » énoncée par un nouveau Moïse. Le contexte, si l’on veut se référer à l’Ancien Testament, évoque plutôt la figure de Josué, qui combat dans la plaine pendant justement que Moïse intercède sur la montagne. Le Jésus de Luc est clairement impliqué dans les « combats » de ce monde. Du reste, son combat est contre le mal, et précisément il soigne (ou honore) là-même « ceux qui sont perturbés par des esprits impurs » et pour cela même « toute la foule » cherche à le toucher parce qu’une « force« , un « dynamisme » [dunamis], sort de lui et les guérit tous.
Cela veut dire que les énoncés de Luc théorisent, en quelque sorte, le combat que mène Jésus contre le mal, combat mené de son côté par le soin ([thérapéouoo], je soigne, j’honore) et la guérison ([iaomaï], je guéris). C’est sans doute pour cela qu’ils se composent autant de bénédictions (commençant par [makarioi], « bienheureux… ») que de malédictions (commençant par [ouaï], « malheureux…« ). Or ce combat, Jésus n’entend pas le mener seul : s’il est descendu au milieu du peuple et y affronte les différentes formes du mal, il « lève les yeux vers les disciples » et s’adresse à eux pour leur dire ces fameux énoncés contrastés. Le « vous » qui se trouve dans ces bénédictions ou ces malédictions, ce sont les disciples.
Mais il faut ici être très attentifs, car la traduction française a semé partout des « vous« , comme s’ils étaient énoncés à chaque demi-sentence. Ce n’est absolument pas le cas !! Je me permets une traduction et je souligne les propositions grammaticales qui sont marquées par le »vous » :
« Bienheureux les mendiants parce que vôtre est le royaume du dieu. Bienheureux les qui-ont-faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Bienheureux les qui-pleurent maintenant, parce que vous rirez. Bienheureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous excluront et vous insulteront et jetteront dehors votre nom comme mauvais à cause du fils de l’homme : réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez, voici qu’en effet votre récompense est abondante dans le ciel, leurs pères faisaient en effet de telles choses aux prophètes ! Cependant malheur à vous les riches, parce que vous touchez votre consolation. Malheur à vous, les qui-êtes-comblés maintenant, parce que vous aurez faim. Malheur, les qui-rient maintenant, parce que vous serez dans le deuil et que vous pleurerez. Malheur, quand tous les hommes parleront bien de vous : leurs pères faisaient en effet de telles choses aux faux-prophètes. »
Que nous apporte ce soulignement ? Il me semble qu’il met en évidence que tous les traits ne visent pas directement les disciples, même si c’est à eux qu’est adressé l’ensemble, sans doute comme une clé pour comprendre le rôle qui leur est assigné par leur maître, leur rôle à l’égard du peuple en faveur duquel lui-même s’investit.
On voit que, de manière parallèle, la quatrième bénédiction et la quatrième malédiction s’adressent directement aux disciples : « bienheureux êtes-vous…, malheur, quand tous les hommes parleront bien de vous… » Dans les deux cas, le rôle auquel celui des disciples est comparé est celui des prophètes, authentiques ou faux. Et on retrouve dans ces deux cas la tonalité matthéenne où une situation apparemment douloureuse est ouverte à une autre interprétation. Que les disciples jouent un rôle de prophète n’est pas une petite affaire : le prophète n’est pas, comme dans Tintin, un Philippilus battant un gong dans les rues et annonçant la fin du monde. D’abord, dans toute la première moitié de l’évangile de Luc, le prophète c’est Jésus lui-même : c’est donc inviter les disciples à jouer le rôle même de Jésus auprès du peuple tout entier, du peuple qu’il s’agit de renouveler. Ensuite, les prophètes ne sont pas seulement des « discoureurs » : si la tradition biblique a certes retenu (ou recomposé) nombre de leurs oracles, elle a aussi retenu des actes, des actes de secours ou de salut au bénéfice de personnes particulières, mais aussi des actes symboliques ou des faits de vie constituant en eux-mêmes une parole signifiante. C’est donc la vie même des disciples qui est appelée à faire signe au peuple tout entier, ils vont vivre et se comporter d’une manière parlante, conscients d’être observés et cherchant à traduire dans leur vie même le message de proximité du dieu qui vient au secours de son peuple et en fait un peuple nouveau -renouvelé.
Mais Luc distingue aussi trois catégories de personnes qui ne sont pas disciples -peut-être peuvent-ils l’être, du moins ce n’est pas parce qu’ils le sont qu’ils sont nommés- : ce sont les mendiants, ceux qui ont faim maintenant et ceux qui pleurent maintenant. Le « maintenant » s’oppose tout au long de ces sentences à un futur, dont on ne sait d’ailleurs pas s’il se situe toujours dans notre registre de temporalité ou s’il fait appel à un « autre monde ». A tout prendre, il me semble tout de même que c’est dans le même régime de temporalité, car le futur est employé aussi, à propos des disciples eux-mêmes : « quand les hommes vous haïront,…. quand les hommes diront du bien de vous… ». Quand Luc écrit, ses lecteurs et lui-même savent que ces temps-là, futurs quant à leur énoncé initial, sont désormais survenus.
Bien. Mais pourquoi donc Luc sélectionne-t-il ces trois catégories de personnes, les mendiants, ceux qui ont faim maintenant et ceux qui pleurent maintenant ? Peut-être parce qu’il s’agit de trois genres de détresses emblématiques, de trois manques des besoins les plus fondamentaux. Ce sont des malheurs qui font ressentir l’injustice de la situation, ce sont des malheurs dans lesquels tout un chacun peut tomber sans qu’il y soit de sa faute. Ce sont des malheurs qui ne sont pas moralement qualifiés. Les disciples sont invités à s’y confronter directement, et ce ne sera pas, ce ne pourra jamais être, en expliquant comment il aurait fallu ceci ou comment il faudrait cela.
Au contraire, les disciples sont eux-mêmes, du fait qu’ils sont disciples, un remède qui soigne ou qui guérit, « …parce que vôtre est le royaume du dieu, ….parce que vous serez rassasiés, …parce que vous rirez » Dès à present, le royaume est confié aux disciples mais non pour eux : pour les mendiants. Et ils en sont bienheureux. Une promesse de rassasiement est portée par les disciples mais non pour eux : pour ceux qui ont faim maintenant. Une promesse de rire est portée par les disciples, mais non pour eux : pour ceux qui pleurent maintenant. Notons au passage cette particularité grecque de Luc, le rire. Ce n’est pas souvent, profitons-en ! Le rire, dans la Bible, c’est plutôt la moquerie, plutôt négatif. Mais dans le monde grec, le rire est un signe de la joie, et c’est ainsi qu’il transparaît ici : si être disciple c’est porter une promesse de rire, voilà qui est magnifique !
En revanche, malheur aux disciples qui sont déjà riches maintenant, aux disciples qui sont déjà comblés maintenant : c’est-à-dire qu’ils ne portent plus une promesse d’un royaume d’avenir, une promesse de transformation. Mais ils se sont installés dans ce monde tel qu’il est et en profitent sans plus chercher à le transformer. Alors oui, malheur à eux et, on le comprend à cause de ce qui a précédé, malheur même tout le peuple, au monde entier.
On peut dire que ces sentences, telles que Luc les rédige et nous les rapporte, sont un vade-mecum du disciple. Faciles à apprendre aussi à cause de leur forme répétitive, elles lui permettent de se souvenir à tout instant du rôle à lui assigné par son maître, d’être en ce monde jamais installé mais porteur d’une promesse, acteur d’un changement et d’un renouvellement. Et de l’être en se tenant de manière privilégiée auprès de ceux qui souffrent, de préférence ceux dont les besoins vitaux, premiers, sont déçus et demeurent béants.