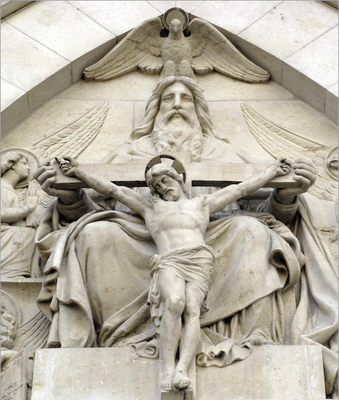Le texte de l’évangile, sur le site de l’AELF.
Une fois n’est pas coutume, voici un texte dont je n’ai pas souvenir d’avoir fait un commentaire ! Il faut sans doute le remettre en contexte, car nous arrivons de la « planète johannique » sur laquelle nous avons pérégriné quelques temps ! Nous voilà donc revenus dans l’évangile de Matthieu : suite au grand discours inaugural appelé communément « discours sur la montagne », Jésus accomplit de nombreux signes. En tout dernier lieu, il a guéri une femme d’une perte de sang, ressuscité la petite fille d’un chef de synagogue, rendu la vue à deux aveugles et fait parler un muet. Et puis il y a comme un résumé de tout ce qui vient de se passer : « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, pour enseigner dans leurs synagogues, clamer la bonne nouvelle du royaume, guérir toute maladie et toute faiblesse.« (Mt.9,35). C’est presque une parenthèse qui se ferme quand, juste avant le discours sur la montagne, on a pratiquement les mêmes mots (Mt.4,23), comme une ouverture de parenthèse. Bref, on peut considérer qu’il y a eu une section et qu’elle prend fin maintenant.
Cela veut donc dire que notre passage serait le début d’une nouvelle section : si tel est le cas, elle va lui donner sa tonalité, c’est le rôle de toute introduction. Or ici, tout commence par un regard sur la foule : « Et regardant les foules, il fut pris aux tripes à leur sujet, parce qu’elles étaient fatiguées et prostrées comme des brebis qui n’ont pas de berger.«
Au début de la section précédente, il était aussi question des foules : « Sa renommée s’en va dans la Syrie entière. Ils lui présentent tous ceux qui vont mal et qui sont oppressés de maladies et de tourments divers : démoniaques, lunatiques, paralytiques… Il les guérit. Le suivent des foules nombreuses, de la Galilée, des Dix-Villes, de Jérusalem, de Judée, et d’au-delà du Jourdain. Voyant les foules, il monte sur la montagne. Il s’assoit. Ses disciples s’approchent de lui. Il ouvre la bouche et les enseigne en disant : Heureux… » Les foules sont déjà là, elles viennent de partout alors que Jésus agit en Galilée, à la frontière syrienne. Elles sont aimantées par son actions contre les maux quels que soient leur forme. Il les voit, et c’est pour cela qu’il monte sur la montagne et prononce le fameux discours. Telle est la première construction de Matthieu. Les foules sont comme une conséquence de l’action de Jésus, une conséquence dont il tient compte.
Maintenant, pourtant, le ton est différent, l’angle de vue différent. Cette section commence par un regard sur les foules elles-mêmes. Et par ce regard, il est « pris aux tripes« , littéralement, puisque le mot est formé sur celui des « entrailles » ou des « intestins ». Et c ‘est vraiment [péri aoutoon], pour elles, au sujet d’elles, en vue d’elles : c’est ce qu’elles sont, ou ne sont pas, ou ce qu’elles pourraient devenir -ou pas- qui le saisit à ce point.Pourquoi ? Que se passe-t-il donc pour provoquer un tel émoi ?

« parce qu’elles étaient fatiguées et prostrées…« Le premier participe [éskulménoï] dit vraiment écorchées, déchirées : soit dit en passant, c’est le nom même, [Skulla], du monstre qui dans l’Odyssée fait face à Charybde, le monstre aux pattes en moignons caché dans une grotte mais doté de six têtes effroyables au bout de six cous d’une immense longueur, et qui chacune capture à coup sûr une proie qu’elle dévore aussitôt qu’elle s’étend hors de la grotte. Ulysse y laisse six compagnons qu’il entend encore crier son nom lorsqu’il raconte son histoire. Ainsi les foules sont-elles « déchirées« . Mais les foules sont aussi [errimenoi], un participe qui vient de [rhiptoo] qui veut dire jeter, lancer, laisser tomber, rejeter, abandonner…
Ces foules ont été baladées, laissées pour compte, rejetées. Elles ont été blessées, elles ont laissé des plumes dans leurs pérégrinations. La traduction officielle « désemparées et abattues » donne l’impression d’une grande fatigue, mais garde un aspect assez subjectif : ce sont leurs sentiments, les foules se sentent comme cela. Mais nos deux participes sont bien des passifs, les foules ont subi des mauvais traitements, physiques (ce qu’implique le premier) et moraux (ce qu’implique le second) ! Est-ce donc à suivre Jésus qu’elles ont subi cela ? On ne sait pas. Peut-être. Peut-être cela leur a-t-il coûté beaucoup de le suivre « dans tous les villes et villages » ; peut-être aussi ces mauvais traitements sont-ils une conséquence de cela parce que le pouvoir en place est gêné par ces mouvements de foule et leur rend la vie difficile.
En tous cas, je trouve que ces foules maltraitées sont d’une grande actualité. Nous avons récemment vu (ou nous sommes allés !) tant de foules dans les rues, tant de gens criant leur malheur, maltraités, trompés, humiliés. Je parle de notre actualité récente en France, mais regardons de par le monde : tant de foules sur les routes, tant de déplacés, tant de gens qui voudraient bien être des réfugiés -mais il faudrait pour cela qu’ils trouvent refuge, or ils trouvent la mort dans le naufrage, la maltraitance dans les geôles des passeurs… Ces colonnes de gens qui remontent vers les Etats-Unis à travers l’Amérique centrale et le Mexique, ces gens qui fuient la Syrie, l’Ukraine, l’Iran, ces foules de Rohingyas fuyant la Birmanie, ces Ouïghours cherchant où aller…Il me semble que ce sont toutes ces foules fuyant de par le monde que Jésus regarde maintenant et qui le prennent aux tripes.
Ces foules sont « comme des brebis sans berger. » L’expression, cette fois est biblique. Matthieu évoque (il ne cite jamais mot pour mot comme on fait aujourd’hui) Ez.34,5 où le prophète prophétise contre les « bergers d’Israël », contre les responsables. Ils ont profité des « brebis », les chefs ont profité des gens, ils se sont enrichis et renforcés en les affaiblissant, « vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n’êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n’avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n’avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. » Quelle charge est évoquée par Matthieu à travers ces quelques mots.
Et ces mots interprètent le regard de Jésus, ils disent que cet état des foules n’est pas la conséquence de leur venue à Jésus, mais plutôt l’état dans lequel leurs chefs les ont laissé jusqu’à présent. Il voit des foules venir à lui, et il voit dans ces foules tous ceux qui ont été livrés à eux-mêmes, errant, jusqu’à présent. Ils voit ceux qui ont été opprimés, ceux dont on s’est servi, ceux qui ont été manipulés, dont on a profité. On commence à dire maintenant la manière dont Kim Jong-Un traite le peuple nord-coréen : il l’appauvrit volontairement et le place sous surveillance renforcée, pour que chacun quête sa subsistance et ne puisse s’occuper d’autre chose, et que chacun se méfie de son voisin et craigne d’être dénoncé par lui. Les brebis sont dispersées. Je ne fais pas un parallèle strict avec les foules de Judée à l’époque de Jésus, mais je veux dire que ce qui est suggéré est analogue. Cette foule souffre, comme collectif.
Alors il s’adresse à ses disciples -qui sont du fait même distincts de la foule. Il s’adresse à ceux qui écoutent et accueillent sa parole durablement pour en changer leur vie, au sujet de ceux qui viennent de loin pour l’écouter parce que, peut-être, il y a là quelque chose de différent de ce qu’ils vivent habituellement, quelques chose qui pourrait less sortir de la situation à laquelle ils sont réduits.
Et il parle de moisson. La moisson, c’est à la fois une réalité et un temps. La réalité de céréales nombreuses arrivées à terme, et un temps à ne pas rater, une fenêtre dans le temps qui s’ouvre à un moment (avant, ce n’est pas mûr) et se referme à un autre (après, les grains sont pourris). C’est un moment à saisir, un temps à vivre. Cette moisson est abondante, et en regard les ouvriers sont peu. Il y a beaucoup à récolter, il y a peu pour le faire.
Et la mission des disciples, c’est « demandez donc au seigneur de la moisson qu’il fasse sortir des ouvriers dans la moisson. » Ce « demandez », c’est le cri d’une absence, car le verbe [déoo] dit d’abord un besoin criant, un nécessaire qui n’est pas là. Il ne s’agit pas du verbe habituellement employé pour la prière formulée, [prosekeuomaï], c’est bien une sorte de béance dont il est question, un manque. La « demande » dont il est question n’a pas de mots, elle consiste dans une absence à laquelle on ne se résout pas.
Les disciples sont donc invités à regarder eux aussi les foules, à partager la « prise aux tripes » de Jésus devant tant de souffrances physiques et morales, et devant tant de maltraitances de la part de leurs responsables. Les disciples ne peuvent en aucun cas être les alliés du pouvoir établi, simplement parce qu’il est établi. Ils partagent la compassion de Jésus. Et ils voient ces foules comme pleines de fruits mûrs, qu’il faut aller cueillir. C’est le temps, c’est le moment, et il se pourrait que tous ces fruits, pourtant engendrés par tant de souffrances et de vicissitudes, soient perdus !! Ce serait terrible !! Alors la vie de ces gens n’aurait plus aucun sens ! Il a auraient vécu tout cela pour rien !
Voilà qui laisse bouche bée, voilà qui laisse sans voix. Mais cette béance, les disciples ont ordre de l’orienter vers « le maître de la moisson » et de toutes choses, vers celui qui a été assez puissant pour susciter du fruit dans ces chemins de mort, pour tirer du coeur de ces gens des grandeurs inestimables au beau milieu de ces situations si épouvantables. Mais ils ne le savent peut-être pas. Sans doute, si on leur dit, ils diront « c’est normal ». Mais non, ce sont des merveilles qui sont sorties de leurs coeur et de leur vie. Il faut quelque’ un pour les recueillir, pour les révéler.
D’où sortiront les « ouvriers dans la moisson » ? Peut-être dans ce groupe des disciples béants à la fois devant tant de souffrances et tant de merveilles. Peut-re dans ces foules elles-mêmes, moisson en attente où tant de fruits déjà sont apparus. Qui sait ? On n’enferme pas l’esprit. En tous cas, voilà la disposition initiale à toute cette nouvelle partie de l’évangile de Matthieu, il faudra nous en souvenir. Bien sûr, il reste en core quelques versets au texte d’aujourd’hui : une autre année ?